
De la sérénité : une approche transdisciplinaire
Ana Maria Peçanha (sous la direction de)
M@gm@ vol.14 n.2 Mai-Août 2016
DE L’IMPÉRATIF DE LA SÉRÉNITÉ POUR UN LEADERSHIP EN EAUX TROUBLES
Jawad Mejjad
jawad.mejjad@orange.fr
Docteur en sociologie, chercheur au CEAQ-La Sorbonne, chef d’entreprise (dans le secteur de l’électronique). Enseigne au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) pour le Master Marketing-Vente, et à l’ISTEC (École de commerce) pour le Master Finances. Ses réflexions et recherches portent principalement sur les valeurs et les structures d’organisation de l’entreprise à l’aune de la postmodernité.
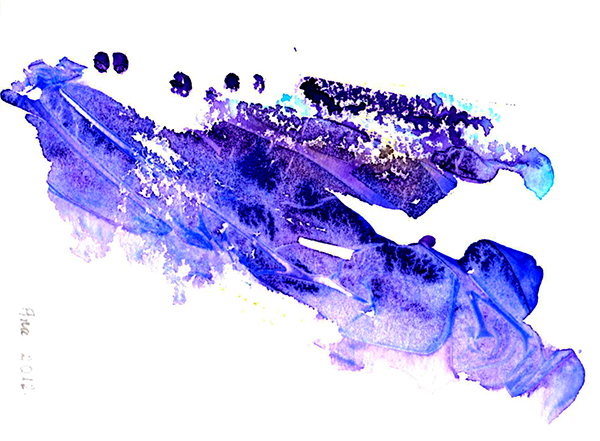 Aquarelle : Imaginaire (Ana Maria Peçanha) |
S’il est une valeur indiscutable actuellement, ce pourrait bien être la sérénité. Il est improbable pour ne pas dire impossible de trouver quelqu’un de nos jours, ne la valorisant pas, ou ne la recherchant pas. Qui ne souhaite pas maitriser la situation, avoir des relations pacifiées avec les autres, se sentir calme et serein ? Qui préférerait les situations tendues, les relations conflictuelles, se sentir angoissé ? Le problème commence à se poser quand nous considérons la sérénité comme la norme, obligatoire. Et c’est justement ce caractère impératif, indiscutable qui devrait nous alerter. En effet, tout ce qui relève de la doxa se trouve être au fondement de nos manières de vivre ensemble, et nous renvoie à nos mythes fondateurs et à notre inconscient collectif. Et c’est précisément en questionnant ce qui ne se discute pas, en nous étonnant devant ce qui paraît évident, que nous pourrons peut-être trouver un angle pour mieux observer et dénicher des éléments explicatifs et ou significatifs, à même de contribuer à une meilleure compréhension de notre société : la société est avant tout, constituée par l’idée qu’elle se fait d’elle-même (Durkheim). La sérénité fait partie, subrepticement et sans qu’on la questionne, de ces valeurs porte-drapeaux de la société telle qu’elle voudrait être. Mais dès lors, que signifie cet impératif de sérénité dans la société moderne, et plus particulièrement dans cette période de mutation sociale, si troublée ? Ne serait-ce pas plutôt l’image de calme extérieur que doit arborer le noyé pour qu’il ne coule pas, ou de l’agitation interdite à celui qui est en train de s’enfoncer dans les sables mouvants ? Ou encore l’obligation d’affichage d’un ordre qui nous fuit dans notre vécu et nos représentations ?
Pour comprendre cet impératif social, il nous paraît judicieux de l’observer dans l’organisation typique de la modernité, c’est-à-dire l’entreprise. L’entreprise est devenue le lieu du stress et du mal vivre, avec force burn-out et maladies psychiques allant jusqu’au suicide. Dès lors, ce que l’on a tendance à demander presque exclusivement à un manager aujourd’hui, c’est d’éviter les conflits dans son équipe et avec les autres équipes. Autrement dit, le leader sera celui qui saura pacifier les relations, donner confiance aux autres en leur permettant de naviguer sereinement dans un monde trouble. Plus précisément, la compréhension de la sérénité comme valeur discriminante dans le monde de l’entreprise nous permettra d’affiner notre approche, en nous posant la question notamment de la sérénité comme composante du leadership moderne, et comme axe de communication. A vouloir à tout prix éviter les troubles et bannir les conflits, n’est-on pas arrivé finalement à une société sclérosée par le politiquement correct ? Et pour reprendre Nietzsche, ne sont-ce pas les dissonances qui enrichissent une harmonie ?
Pour répondre à notre question, nous allons d’abord nous intéresser aux origines de notre modernité et aux valeurs qui l’on fondée, à savoir la maîtrise de soi et de la nature, avant de nous poser la question de la relation entre sérénité et leadership dans l’entreprise, en nous demandant s’il n’y aurait pas des facettes positives au conflit.
La modernité et le rejet du conflit
Nous avons une aversion pour la violence. Du moins le monde occidental. Il n’est qu’à constater, pour s’en convaincre, notre désarroi devant les attentats, notre rejet des guerres, ou même les commentaires outrés devant les chiffres de la délinquance. Toute violence nous heurte. Elle remet en cause notre modèle civilisationnel : seuls les barbares sont violents. L’homme moderne est un homme de dialogue, de consensus, de maîtrise. La violence est une perte de contrôle, or la modernité s’est fondée sur le crédo cartésien : « maître de moi et de la nature ». Mais d’où vient cette aversion pour le conflit, et cet impératif de maîtrise ?
Toutes les civilisations, et loin s’en faut, n’ont pas toujours condamné la violence. La guerre a été pendant longtemps l’activité noble, qui structure la hiérarchie sociale dans le groupe ou la cité, et entre les cités. Dans nombre de civilisations (grecque, romaine, perse, égyptienne, …), de tribus, de récits mythologiques (L’Iliade et l’Odyssée, le Mahabharata, …), l’exaltation du guerrier est la norme. L’histoire de chaque pays est une valorisation exacerbée des victoires militaires, et Dieu lui-même ne rechigne pas à la violence pour châtier les infidèles. Le tour de force de la modernité est d’avoir sublimé la violence, comme le montrent les travaux de Norbert Elias notamment. La violence va devenir le monopole exclusif de l’État. Rappelons-nous que la genèse de l’État moderne est consécutive au développement d’une nouvelle société, fondée non sur le groupe mais sur l’individu, cet individu autonome (c’est-à-dire, étymologiquement, qu’il est sa propre loi) qui doit cohabiter avec des semblables, égaux et néanmoins concurrents. Dans ce monde où forcément l’homme est un loup pour l’homme (Hobbes) et où le plus fort risque d’asservir le plus faible, l’État a la responsabilité de la régulation des forces en présence et prévenir l’utilisation de la coercition et de la violence. « La mise en place d’un monopole militaire et policier donne en général lieu à la création d’espaces pacifiés, de champs sociaux à l’intérieur desquels l’emploi de la violence ne saurait être que l’exception » (N. Elias, 1975, p.188).
La guerre a toujours été le moyen le plus utilisé pour augmenter sa puissance et sa richesse. Traditionnellement, les trois moyens pour s’enrichir ont été soit l’exploitation de la nature (agriculture, pêche, chasse), soit l’extraction du sous-sol (mines), soit prendre la richesse des autres (les razzias, les pillages, la guerre). Et souvent, c’est ce dernier moyen qui a permis les plus grandes expansions et les plus puissants empires, que ce soit en Chine (unification des trois royaumes), en Grèce, en Perse, ou plus proche de nous la campagne napoléonienne ou les guerres coloniales. Ce mouvement de captation de la violence par l’État est bien analysé par N. Elias pour l’Occident et plus particulièrement en France, en forgeant le concept de curialisation : la constitution des cours royales, lieu de transformation des guerriers en courtisans. « En Europe, la curialisation des guerriers débute graduellement à partir des XIè et XIIè siècles et s’achève au XVIIè et au XVIIIè siècle. Au départ, nous voyons un territoire parsemé de châteaux forts et d’exploitations agricoles […] Peu à peu on voit émerger, dans chaque région, du grand nombre de châteaux et de maisons domaniales, quelques-uns dont les maîtres jouissent d’une position de suprématie, parce qu’ils ont réussi, au cours de nombreux combats, à agrandir leurs domaines et leur puissance militaire » (N, Elias, 1975, p.221).
Cette curialisation a accompagné la transformation fondamentale de la société occidentale à la Renaissance, pour basculer vers la modernité et toutes ses valeurs fondées sur l’individu, la raison et le progrès. Or le point fondateur de toutes ces valeurs est le rejet du conflit, dont l’origine fondatrice est le traumatisme laissé par les guerres de religion (1562-1598). Bien sûr, et comme nous l’avons mentionné, les guerres ont toujours été le quotidien des populations au Moyen Agen et notamment la guerre de cent ans (de 1337 à 1453) entre la France et l’Angleterre, qui par sa durée, avait banalisé l’état conflictuel. Ce qui a changé avec les guerres de religions entre catholiques et protestants, c’est son caractère de guerre civile qui fait tuer le voisin par le voisin et l’ami par l’ami. Beaucoup des comportements occidentaux actuels trouvent leur explication dans ce refoulé, et plus particulièrement en France : la méfiance du communautarisme, le confinement du religieux au privé, l’idéalisation de la laïcité, l’aversion au conflit. Rappelons-nous que Montaigne, contemporain de ces guerres de religion, ouvre les Essais par un premier chapitre consacré à la question de comment sauver sa vie, « comment adoucir les cœurs de ceux que l’on a irrité, lorsque, ayant la vengeance en main, ils nous tiennent à leur merci » (Montaigne, 2009, p.13). Question sur laquelle il reviendra vers la fin de son œuvre, au livre III chap8, pour lui donner un autre éclairage : au début sa réponse est soit d’essayer de provoquer chez l’assaillant la pitié (réponse religieuse), soit réagir par la bravoure (réponse militaire), à la fin des Essais, il va proposer plutôt de susciter la bienveillance en présentant un visage et une attitude affables (réponse de communication). Nous avons là, en condensé, toute l’évolution de la modernité face au conflit : gérer le différend par la négociation.
La sérénité, modèle d’un monde sans conflit
La modernité s’est ainsi développée dans l’idéal d’éradication des conflits, en misant sur la raison d’un individu soucieux de son bien-être et de son intérêt. Le maître mot est la maitrise : maîtrise de soi et du monde. Il s’agit dès lors, la science aidant, de vivre dans un monde contrôlé, prévisible. Car maîtriser, c’est prévoir. Et pour cela, la modernité a privilégié une vision scientiste du monde : réduire la réalité à des équations permettant de la modéliser et de prévoir le futur. C’est cette vision qui a permis tous les succès technologiques de l’Occident pendant trois siècles, qui lui a permis de dominer le monde et d’asservir la terre. Qui lui a donné confiance, pour ne pas dire arrogance, et qui lui a fait croire que la maitrise de tous les aléas était à sa portée. Ce modèle était censé éradiquer les conflits, éliminer les inquiétudes, installer la sérénité. N’oublions pas que la promesse de la modernité était de rapatrier le Paradis sur terre, et de permettre à chacun d’être heureux. La béatitude chrétienne s’est métamorphosée en bonheur, bien souvent confondu avec bien-être. Afficher sa joie de vivre devient un dogme, et rien n’est plus vulgaire que de montrer sa tristesse ou sa douleur, « les sociétés démocratiques se caractérisent par une allergie croissante à la souffrance » (P. Bruckner, 2000, p.50). L’idéal de la modernité étant la perfection, tout défaut, tout raté, tout dysfonctionnement est vécu comme un affront, une remis en cause, une lèse-majesté. Être heureux est un impératif, et « il devient suspect de na pas devenir rayonnant » (P. Bruckner, 2000, p.64). Et être heureux dans notre acceptation, qui est loin de celle d’Aristote qui la caractérise par étant le bien ultime auquel nous aspirons et qui ne peut s’apprécier qu’à l’apogée de la vie, être heureux donc pour nous consiste à réaliser quotidiennement nos désirs, être dans la sérénité tous les jours. Ce que n’aurait compris ni Aristote ni Saint-Augustin, tant ils avaient une conception dynamique du bonheur : un processus et non un état. Le bonheur qui nous est imposé est d’être dans la sérénité permanente. Autrement dit, maitriser tous les risques de dysfonctionnements, de conflits entre les événements et les personnes, établir un consensus et trouver l’harmonie.
D’où le développement du politiquement correct et le psittacisme généralisé, c’est-à-dire l’effet perroquet où chacun répète ce que dit l’autre. Ne surtout pas entrer en conflit, éviter les sujets qui fâchent, rechercher le consentement. Chacun se doit de respecter l’opinion d’autrui, exprimer ses convictions de manière à ne pas heurter l’autre, choisir un langage édulcoré apte à ne pas choquer. Le politiquement correct est mal nommer les choses exprès. Or comme l’a dit Camus, mal nommer les choses, c’est ajouter au chaos du monde. Et de fait, le politiquement correct est une injonction contradictoire : voir les choses et ne pas les nommer. Approuver sans accepter. C’est ce qui génère la schizophrénie de notre société.
La société actuelle se caractérise par des individus isolés, qui à force de rechercher la sérénité et éviter le conflit, affichent un bonheur de façade mais refoulent leurs angoisses et leur tristesse. Et c’est ce refoulement qui est le concept à la base de psychanalyse. Il n’est d’ailleurs pas anodin que la psychanalyse ait émergé dans le sillon de la modernité et soit l’apanage de l’Occident. Comme le note François Roustang, psychanalyste lacanien à ses débuts, c’est notre folle passion de contrôle et de maîtrise qui nous a inculqué un monde paranoïaque, et nous exigeons que « la vie ne nous déconcerte jamais : tel serait l’aboutissement de la cure » (F. Roustang, 1996, p.10). La psychanalyse ne fait que prolonger à la psyché l’idéal de la modernité : abolir tout dysfonctionnement, tout conflit. Ainsi l’homme moderne a été façonné dans le culte de la perfection, de la maitrise des événements, des autres et de lui-même. La sérénité est à ce prix. Or ce bonheur de la morne plaine est-il vraiment souhaitable ? Ne porte-t-il pas en lui-même les germes de sa contradiction ? C’est ce que nous allons étudier maintenant.
Les bienfaits des situations troubles ou l’éloge du conflit
Il est courant de définir la philosophie comme l’art des questions plutôt que des réponses, et qu’il y a donc plus de vertu à chercher qu’à trouver. Ceci pour dire que c’est dans l’adversité des situations que l’esprit est créatif, dans les difficultés que l’intelligence est sollicitée, devant le danger que l’instinct soit mobilisé. Bref c’est le trouble de la situation qui incite à l’action, et non pas le calme et la sérénité. Il est indéniable, et nous l’avons largement montré plus haut, que notre représentation du conflit est négative, mais peut-on concevoir une représentation positive du conflit ?
Nous ne voyons dans le conflit qu’un risque d’éclatement, or une stabilité n’est obtenue que quand des forces contraires s’équilibrent : le conflit est en principe un facteur d’unité. G. Simmel y voit une forme de socialisation, dans la mesure où l'interaction entre individus est socialisation, et le conflit est une forme d'interaction. Il n’y a pas d’unité sans résolution préalable de conflits : « la contradiction et le conflit non seulement précédent cette unité, mais ils sont à l’œuvre à chaque instant de la vie » (G. Simmel, 1999, p.266). Et de préciser qu’un « groupe qui serait tout simplement centripète et harmonieux, une pure et simple réunion, non seulement n’a pas d’existence empirique, mais encore ne présenterait pas de véritable processus de vie. ». Autrement dit, il n’y a pas de vie ans conflit, et ce sont les contradictions qui constituent le groupe. De plus, le conflit est nécessaire aussi pour l’individu, « ne serait-ce que parce que c’est bien des cas le seul moyen qui nous permette de vivre avec des personnalités véritablement insupportables. Si nous n’avions pas le pouvoir et le droit au moins de nous opposer à la tyrannie et au caprice, aux suites d’humeur et au manque de tact, nous ne supporterions pas du tout no relations avec des personnes dont le caractère nous fait souffrir de la sorte ; mais nous serions poussés à de actes désespérés. » ((G. Simmel, 1999, p.269). Nous opposer nous permet d’exister, et nous donne le sentiment de ne pas être écrasés. Le conflit relie, alors que ce sont ses causes - la haine, l'envie - qui dissocient ; le conflit en ce sens est déjà la résolution d'une tension, il fait le lien. C’est dans le conflit, la confrontation que se construit une solution, une vérité partagée. Montaigne avait fait l’éloge de la disputation dans le chapitre « De l’art de conférer » (Montaigne, 2009, p.1116) : « Quand on me contredit, on éveille mon attention, mais non ma colère : je m’avance vers celui qui me contredit ; qui m’instruit. La cause de la vérité devrait être la cause commune de l’un et de l’autre ». La modernité a créé des êtres centrés sur eux-mêmes, à l’égo exacerbé, voulant à tout prix avoir raison, avoir le dernier mot, oubliant en cela la différence entre amour propre et amour de soi (Rousseau). C’est ce préalable de la modernité, rehiérarchisant la société par le concept de compétition qui a dénaturé le conflit et l’a vidé de ses vertus. C’est en revenant, et ce qu’est en train de réaliser la postmodernité naissante, à une société où c’est la relation qui est première et non l’individu que la confrontation, le désaccord, la divergence seront sources de renforcement des liens sociaux.
C’est dans l’adversité que se développent les capacités humaines, c’est parce que les choses ne vont pas comme nous voulons, que nous faisons l’effort de rechercher les solutions. Et de plus, les choses ne vont jamais tout à fait comme on veut. L’insatisfaction est inhérente à l’être humain, et de plus une insatisfaction inquiète pour reprendre Hobbes « C’est pourquoi je place au premier rang, à titre de penchant universel de tout de tout le genre humain, un désir inquiet d’acquérir puissance après puissance, désir qui ne cesse seulement qu’à la mort » (Hobbes, 2000, p.188). Ainsi pour Hobbes, la vie est une course de désir en désir jusqu’à la mort. Il est illusoire de penser trouver un état de repos durable. A peine a-t-on réglé un problème qu’un autre prendra sa place, à peine a-t-on assouvi un désir qu’une autre envie se manifestera. La tranquillité est un idéal jamais atteint, ou alors pendant un court laps de temps. C’est plus d’intranquillité qu’il s’agit, pour reprendre le crédo de Pessoa: « Il est des bateaux qui aborderont à bien des ports, mais aucun n’abordera à celui où la vie cesse de faire souffrir » (F. Pessoa, 1988, p.23). Et pour reprendre la métaphore de Balzac dans son roman « La peau de chagrin », c’est de ses désirs que l’on meurt : le héros voit la peau, métaphore de la vie, rétrécir au fur et à mesure que ses désirs sont satisfaits. C’est quand nous n’avons plus d’envie, plus de désirs que la mort est là. « Tout dans le monde se laisse supporter, sauf une série de beaux jours » (Goethe, cité par F. Jullien, 2005). Combien de salariés meurent dès leur retraite prise, installés dans une inactivité ennuyeuse, une tranquillité morbide, loin des difficultés de l’activité, c’est-à-dire de la vie.
Le leader comme gestionnaire des conflits
Justement qu’en est-il dans l’entreprise ? Rappelons que l’entreprise est l’organisation paradigmatique de la modernité, comme l’Église l’a été pour le Moyen Age, et l’armée pour les Grecs et les Romains. Ce qui s’y passe traduit de manière concentrée le fonctionnement de la société dans sa globalité. D’organisation permettant au salarié de se réaliser, l’entreprise est perçue actuellement comme un lieu de souffrance, et tous les cabinets de formation proposent des stages qui ne désemplissent pas sur la gestion des conflits. On y apprend à mieux gérer ses émotions, à mieux communiquer, à mieux gérer son stress. Le rôle du cadre a ainsi évolué d’un accompagnement pour faire monter en compétence son équipe, vers un rôle de communication avec pour principal objectif d’éviter les conflits (J. Mejjad, 2013). Et c’est là que se situe la différence majeure entre un cadre, c’est-à-dire un manager, et un leader. Un manager est désigné par sa hiérarchie, c’est un statut, un chef imposé à une équipe. Alors qu’un leader sera reconnu comme tel par les membres de son équipe, et son pouvoir lui vient des relations qu’il noue avec les autres membres du groupe. Quand le manager veillera à mettre de l’ordre, le leader s’attachera à donner du sens. Le leader est celui qui va permettre à chacun de réaliser ses envies, d’atteindre ses objectifs : il est au service des aspirations de chacun. Alors que pour le manager, ce sont les personnes qui sont au service de l’objectif de l’entreprise. Rappelons-nous le dialogue entre Léonidas et Xerxès, dans le film « 300 » : Xerxès s’adresse à Léonidas pour le convaincre de se rendre avec l’argument qu’il a 100.000 soldats et chacun est prêt à mourir pour lui, ce à quoi répond Léonidas, que lui est prêt à mourir pour chacun de ses soldats. C’est quand il synthétise les aspirations du groupe et qu’il protège le groupe que le manager est reconnu comme leader. Et synthétiser les aspirations ce n’est pas supprimer les conflits, c’est au contraire s’y adosser.
A l’instar de ce qui se passe dans la société, l’entreprise a entrepris d’éradiquer les conflits, et rêve d’une organisation zen, sereine. La communication notamment dans les entreprises de la nouvelle technologie (Apple, Google, …) nous montre des organisations cool, tant dans l’habillement que l’aménagement des bureaux et des espaces communs remplis de baby-foot, de hamacs et de sofas. Le relations sont censées être sereines, amicales. C’est l’image que veulent véhiculer les start-up. Et il n’est pire scénario pour une entreprise que de se retrouver dans des situations de conflit (souvenons-nous d’Air France et de l’épisode de la chemise arrachée, ou encore de la période noire des suicides chez Orange ou chez Renault). Or comme nous l’avons vu plus haut, c’est une vue de l’esprit, aveuglé par son idéologie, que de vouloir vivre dans la sérénité, sans conflit. Le conflit est inhérent à la vie, à l’extérieur comme à l’intérieur de l’entreprise.
Le leader ne sera pas celui qui va gérer les conflits en les empêchant d’être, mais au contraire qui va les laisser s’exprimer et les canaliser pour le bien du groupe. L’objectif du manger en empêchant les conflits, est louable : éviter l’éclatement de la violence. Mais ce faisant l’entreprise ne fait que générer une violence bien plus pernicieuse, une violence symbolique beaucoup plus dévastatrice. Quand la finalité est d’avoir un groupe où la violence n’est jamais apparente (un interdit majeur par exemple dans l’entreprise est de se mettre en colère), et quand l’impératif est « battez-vous, mais avec le sourire », la violence est refoulée et le ressentiment est latent, avec tous les ravages que nous constatons. Avec comme conséquence la généralisation du stress : « terme technique, du moins au départ (la métallurgie), mais dont s’est emparé avec autorité et réactivement la pensée commune » (F. Jullien, 2005, p.140).
Conclusion
La recherche impérative de la sérénité comme état permanent est le pendant de notre refus idéologique du conflit : « héritiers d’une époque qui a longtemps cru à la possibilité d’en finir un jour avec le conflit, nous sommes aujourd’hui, pour cette même raison, effrayés face à tout ce qui menace nos vies et nos sociétés » (M. Benasayag et A. del Rey, 2012, p.7). L’ontologie de l’égalité et du bien, fondée sur la raison, n’est plus opératoire. Il nous faut prendre acte de l’anthropologie conflictuelle de l’homme, qui est irréductible. Au lieu de la nier et de générer une violence symbolique plus destructrice que celle que nous voulons éviter, et de nous installer dans une sérénité de façade, intégrons plutôt cette dimension dans nos relations et nos comportements. La question à se poser est comment organiser la conflictualité, irréductible, des hommes entre eux, étant donné que chacun veut augmenter sa puissance, qui trouve sur son chemin la puissance de l’autre. Chacun veut conserver son existence, protéger ses biens, assurer la tranquillité des siens, et assouvir ses désirs. Or les désirs sont toujours les désirs de l’autre (cf. René Girard), et la conflictualité est première. De plus le monde ne nous est pas donné, il nous est contingent et nous devons faire avec. Le rêve de la modernité de soumettre la nature a fait long feu, et les situations que nous rencontrons sont problématiques. La question au bout du compte n’est pas d’être serein, mais d’organiser la conflictualité entre les hommes et avec le monde, pour aller vers une sérénité inatteignable.
Bibliographie
M. Benasayag et A. de Rey, Éloge du conflit, La Découverte, 2012.
P. Bruckner, L’euphorie perpétuelle. Essai sur le devoir de bonheur, Grasset, 2000.
N. Elias, La dynamique de l’Occident, Calmann-Lévy, 1975.
T. Hobbes, Léviathan, Le livre de Poche, 2000.
F. Jullien, Nourrir sa vie. A l’écart du bonheur, Le Seuil, 2005.
J. Mejjad, Le mythe du pouvoir de la communication dans la modernité, M@gm@, Vol.11 n.2 2013.
M. Montaigne, Les Essais, Quarto Gallimard, 2009.
F. Pessoa, Le livre de l’intranquillité, Christian Bourgeois Éditeur, 1988.
F. Roustang, Comment faire rire un paranoïaque ?, Odile Jacob, 1996.
G. Simmel, Sociologie. Etudes sur les formes de la socialisation, PUF, 1999.


 DOAJ
Content
DOAJ
Content
newsletter subscription
www.analisiqualitativa.com